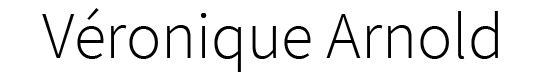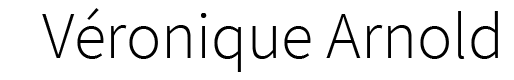Entretien avec Dominique Bannwarth, journaliste, président de Mulhouse Art Contemporain,
D ’emblée, le titre de l’exposition L’éclat d’une luciole dans la nuit, renvoie à quelque
chose de sensible?
Je reprends les propos d’un être humain amérindien du XIXe siècle qui essayait de définir la vie de cette manière: «Qu’est-ce la vie? C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit».
Depuis quelques mois, j’étais à la recherche d’un titre pour mon exposition à la Fondation Ghisla à Locarno et quand j’ai lu cette phrase, je me suis dit que c’était ainsi que j’aimerais présenter mon travail.
J’ai l’idée de la lumière d’une luciole dans la nuit comme d’une lumière dansante, légère, qui apparaît puis s’estompe.
A ce titre, j’ai aimé l’expression «l’éclat» d’une luciole, et non pas «la lumière» d’une luciole.
Nous vivons à une époque où il est très difficile d’apercevoir les nuances.
C’est comme si nous nous attendions toujours à voir des lumières extrêmement fortes et puissantes qui s’imposent à notre regard.
Cette expression «d’éclat» pour désigner cette toute petite lumière de luciole dans la nuit est très belle.
Dans mon travail, il me semble que j’essaie en permanence de rendre leur éclat à des choses toutes simples, qui pourraient passer inaperçues: les pliures des feuilles sèches de ginko lorsque l’eau s’est retirée, les calligraphies que forment de petites branches de bruyère lorsqu’elles sont projetées sur un mur, les ombres des feuilles, la poésie de mots gravés sur du verre, d’interminables broderies de mots sur du textile, le bruissement des feuilles dans le vent, le mouvement de l’eau, la tendresse d’une intonation de voix…
Ce retour vers le sensible te ramène aussi à la nature?
Oui, nécessairement, la nature, c’est aussi ma propre nature.
Sans doute que je n’ai jamais quitté ce que je ressens comme ma nature profonde, ce sentiment d’exister, naturel, libre, archaïque.
Il m’a toujours semblé artificiel de vivre en ignorant cette nature et tout ce qui nous constitue, les sentiments, les émotions, notre manière d’appréhender le monde qui est si multiple.
Une nature presque animale.
J’ai toujours estimé que c’était là mon trésor pour la vie.
Il m’est arrivé d’en être éloignée, mais j’ai toujours vécu cet éloignement comme une souffrance, une tension désagréable, un sentiment d’inaccomplissement.
Ce caractère très sensible renvoie évidemment à quelque de chose de vivant, quelque chose d’animé, quelque chose aussi qui permet de lutter contre le sentiment de l’inexi- stence, voire de la mort?
Oui, c’est ça, je pense à l’âme, à «l’anima»…
Il me semble que ce qui nous permet réellement de nous sentir vivants dans cette existence com- plexe, c’est ce que nous appelons l’âme.
C’est une multitude d’émotions, de perceptions du réel, de transcriptions de ce qui nous arrive et si nous sommes coupés de cette force qui est une force sauvage, indomptable, nous perdons notre énergie et notre vitalité.
Il s’agit d’affirmer la force du vivant, sa vibration…
C’est très beau, ton évocation de la vibration: comment vibrer, comment ne pas cesser de
vivre dans la vibration aux êtres et aux choses.
Nous ressentons très clairement les moments où nous sommes en vie lorsque nous cessons de l’être.
Mais lorsque nous nous sentons vivants, nous vibrons.
Au contact d’un être humain qui nous touche, au contact d’une feuille qui tombe, au contact du vent qui soulève tout à coup le tissu d’un passant devant nous: c’est tout cela le vivant, cette perception très fine de ce qui nous entoure…
C’est cela qui me fait sentir vivante.
Je pense aux propos du peintre Lucian Freud, petit-fils de Freud, qui disait «je veux que la peinture fonctionne comme la chair».
Pour moi, il parlait aussi des pulsions.
Dans mon rapport aux êtres humains, c’est le vivant qui m’intéresse, les pulsions, les sentiments, les impulsions, ce qui ne se dit pas et qui détermine les relations.
J’essaie de voir au-delà du masque, des déguisements.
Il y a l’humain, mais il y a aussi tout notre environnement. Tout cela constitue l’altérité.
Il y a évidemment une différence de perception entre ce que je peux ressentir de l’autre humain quand je suis en relation avec lui et ce que je peux ressentir au contact d’un arbre par exemple, mais c’est l’idée d’une altérité permanente à laquelle nous sommes confrontés, et à laquelle nous avons à répondre, en tant qu’êtres humains.
Justement, par rapport à cette empathie, cette résonance que tu vas ressentir au contact de la nature, du monde, comme cela aussi été le cas pour le cosmos lors d’une précédente exposition, il s’agit de transcrire cela à travers un langage, quelque chose de structuré, même si la pensée est poétique…
Tu soulèves ici la question du langage; je dirais qu’avant tout, je suis comme une membrane qui répond à ce qui l’environne.
Face à mon sentiment d’impuissance à pouvoir traduire ce qui se passe au contact de tout ce qui m’environne, je suis amenée à créer quelque chose et à inventer un langage pour répondre à toutes ces sollicitations.
Ce langage particulier que je suis obligée d’inventer pour pouvoir vivre, c’est la création plastique, ce sont mes mots, c’est l’écriture.
Mais je me rends compte, au fur à mesure de mon travail, que la structure du langage que j’utilise dans mes créations est étrangement similaire à la structure du vivant tout autour de moi.
Les images de l’univers au télescope ou les images des entrailles d’un arbre au microscope électron- ique sont structure, sont langage.
Je pense ces structures. Je suis aussi ces structures.
C’est un sentiment très beau d’être intégrée à ce point à tout ce qui nous environne.
Partant de quelque chose qui est empathique, intuitif, émotionnel, comment dans la créat- ion cette notion de structuration du langage, à travers les formes, les matériaux, le discours éventuellement qui peut sous-tendre un travail artistique, s’opère cette étape suivante qui fait qu’au-delà de la perception, tu vas pouvoir restituer dans une forme structurée, langa- gière, artistique, formelle les choses?
C’est une question difficile… c’est quelque chose qui est à l’œuvre en moi, à mon insu, je ne sais pas comment je procède exactement…
Nous naissons dans un monde où le langage est déjà constitué. Le langage nous précède.
La première fois que la nécessité d’avoir recours à un langage artistique est apparu, c’est lorsque mon père est décédé brutalement. J’étais adolescente.
Face au réel de la mort et de la disparition d’un être aimé, il n’y avait plus rien.
A partir de cet effondrement symbolique, j’ai ressenti la nécessité de construire un langage personnel pour faire face à cette situation intenable.
C’était une expérience que je qualifierais d’initiatique.
Par la suite, c’est toujours ainsi que j’ai fonctionné, par bouleversements, par effondrement, par réaction, par émotion, par re-création: je suis quelqu’un d’extrêmement bouleversée par tout ce qui m’arrive.
C’est ce bouleversement qui est à l’origine de la création.
Comment je crée après le bouleversement?
C’est sans doute un mélange entre ce que la société nous inculque de techniques, de possibilités et quelque chose de plus archaïque, de plus sauvage.
C’est toujours un aller-retour entre une cert
aine forme de sauvagerie et la culture.
Tu as ta propre culture, ta propre éducation artistique, intellectuelle, poétique, philo- sophique, peut-être psychanalytique… est-ce que toute cette armature de la pensée qui préexiste déjà peut entrer en conflit avec ce que tu ressens ou, au contraire, ne va-t- elle pas essayer de maîtriser ce que tu ressens?
Je pense que je suis plus sauvage que cultivée.
Mais il y existe un dialogue fructueux entre mes sensations, émotions, sentiments et les textes et œuvres d’art qui m’environnent.
Cela m’intéresse beaucoup de découvrir comment d’autres humains vivent, pensent et créent. Il y a des points communs.
La diversité des formes de vie et de pensée alimente ma pensée, mais aussi ma manière d’être sensible.
Tout passe par le corps, plus que par l’esprit?
Ce sont les sensations, les émotions qui m’amènent à la nécessité de penser ce qui m’arrive, pas l’inverse.
Mais l’esprit prend le relai.
Il ne laisse pas la sensation s’éteindre.
Il y a des artistes qui utilisent leur propre corps de manière performative. Est-ce que c’est quelque chose que tu as expérimenté?
J’ai connu une période où j’ai fait cela.
Je travaillais avec un musicien, j’étais sur scène, je peignais en résonance avec la musique de JS Bach qu’il jouait à ce moment-là.
J’avais dressé une paroi transparente entre le public et nous et je peignais sur cette paroi à l’encre de Chine avec de grands pinceaux.
C’était comme une danse, un travail sur le corps.
Cette question me fait penser à l’œuvre d’Anna Mendieta qui a fait un travail sublime sur le corps. J’aimerais beaucoup continuer à travailler sur le corps d’une autre manière.
Il y a une forme de mise en danger dans ce fait d’être un corps animé par la vie, une sorte d’abîme qui s’ouvre tout-à-coup, qu’il faut habiter…
Tout le temps oui…
Je suis au monde sans protection, sans peau, sans capacité d’éloigner le réel de moi, donc, je suis dans ce danger-là, dans ce risque.
Ma création, cela va être de broder un filet au-dessus de l’abîme, pour m’empêcher de tomber, pour pouvoir continuer de danser.
Tu décris ce qui est finalement ton «appréhension» du monde, et dans cette expression il y a aussi quelque part la peur, qui peut être quelque chose qui fige, le pensée, le corps parce quand on est transis de peur, on est souvent paralysé… Tu transgresses cette peur à travers le geste artistique?
A travers le souffle. Tu parles de la peur, mais je dirais même l’angoisse.
Un jour, j’en parlais avec un ami écrivain, je disais à quel point c’était difficile de vivre l’angoisse; il me disait «tu as beaucoup de chance de connaître ça».
A l’époque ça me paraissait étrange comme idée, mais avec le temps, je me dis que c’est une chan- ce de ressentir avec une telle intensité ce qui peut nous saisir d’incompréhensible de l’existence. Comment lutter contre l’angoisse par le travail? La question est plutôt de travailler avec l’angoisse. Le souffle, c’est la parole, c’est la vie; le travail artistique, c’est un travail de respiration, une recher- che d’équilibre, une danse au-dessus du vide…
Dans cette exposition, tu utilises de multiples matériaux. Comment se détermine le choix de ces matériaux, la broderie, le bois, la céramique… comment s’arbitrent les choses dans le choix du geste artistique, de la création de l’objet artistique?
Ce qui est toujours à l’origine d’une œuvre, c’est un sentiment, et en général le sentiment le plus déterminant, c’est un sentiment de déchirement proche d’un effondrement; c’est ce qui va m’ap- peler à créer quelque chose avec un matériau appropriée.
Par exemple dans cette exposition, je vais montrer un kimono en soie floquée, presque transparente, saupoudrée de feuilles en porcelaine légère, presque translucide, toute fine, toute fragile.
A l’origine de ce travail, c’est vraiment un sentiment de bord d’abîme et en même temps à cet en- droit-là, tout fin, tout ténu, il y a le sentiment de la plus grande poésie, et je ne sais pas pourquoi c’est à cet endroit-là, mais c’est souvent le cas.
A l’instant où j’ai ressenti ce sentiment de chute et de déréliction, j’ai senti que j’avais besoin de tou- cher de la soie, que la soie était la chose la plus proche de la peau, que la peau était la traduction à la fois de notre force interne et de notre fragilité extérieure…
Quand je me sens envahie d’un sentiment d’une très grande fragilité comme celui-là, je touche de la matière.
Dans ce cas, c’est de la soie, une soie fine, mais si solide; elle a l’air fragile, on a l’impression qu’elle va se déchirer tout de suite, mais elle est d’une résistance incroyable.
C’est là où c’est subtil, sensible, qu’il y a une énorme force de vie.
Je pense aussi aux fleurs de printemps. Quelle surprise de découvrir, au mois de mars, alors qu’il fait encore si froid, les fleurs les plus fines, les plus raffinées, les plus belles de l’année… elles ont l’air extrêmement fragiles mais ce sont elles les plus robustes!
Il y a une matière qui t’a particulièrement inspiré pour cette exposition, c’est le bois.
Et là, tu as travaillé d’une manière d’abord très rationnelle avec un scientifique – comme cela avait été le cas pour le cosmos lors de ton exposition à Bâle. Comment s’établit cette relation et comment utilises-tu ensuite cette connaissance maîtrisée, ce corpus scientifique?
Il y a deux œuvres qui sont en relation avec le bois qui sont présentées dans l’exposition.
La sphère en bois de bruyère que j’ai réalisée avec Edmondo Wörner, mon collaborateur et les bro- deries d’images de fibres ligneuses au microscope électronique, réalisées en collaboration avec un chercheur de Varsovie.
En ce qui concerne le travail de collaboration scientifique, c’est un ami botaniste qui m’a rendu attentive au travail de son collègue polonais. La relation qui s’est établie est due à des affinités inat- tendues et merveilleuses.
Je ressens avec gratitude toutes ces amitiés qui me soutiennent et me touchent.
Lorsque j’ai vu ces images au microscope électronique, j’ai été émerveillée par la beauté et la com- plexité incroyables du monde intérieur du bois d’arbre.
Il y a une forme de perfection dans cette esthétique, non?
Oui, la nature nous offre des formes parfaites.
Cela pose la question de la reproduction de cette perfection de la nature?
Quand je crée, je ne copie pas le réel, je rends hommage à la beauté infinie du réel sous toutes ses formes.
J’aime épouser le réel, le caresser, l’aimer. C’est un acte amoureux.
C’est reconnaître la beauté de ce qui m’environne.
Moi, tout ce que j’ai, c’est ma petite machine à coudre et ma sensibilité…
La broderie a une relation au temps… Il n’y a pas d’immédiateté:
Broder, c’est très long, très décourageant souvent.
Quand j’ai commencé ces broderies de fibre d’arbre, je me suis dit: -tu dénatures, c’est beaucoup plus beau en vrai, qu’est-ce que tu fais?
Mais lorsque je poursuis ce travail, j’ai l’impression de sculpter à partir de l’existant. Et c’est une très belle sensation.
Un autre aspect des œuvres présentées dans cette exposition s’articule autour des om- bres qui d’une certaine manière nous renvoient à la caverne platonicienne,
ces ombres que la nature crée avec la lumière, l’ombre n’existe que quand il y a de la lumière… c’est sortir de l’obscurité, l’ombre?
C’est d’abord une nostalgie, c’est ce regard en arrière que tu évoques avec la grotte de Platon, par rapport à quelque chose qui me précède et que j’ignore…
La lumière des étoiles, c’est la lumière de corps qui ont disparu depuis longtemps et qui nous par- viennent de manière miraculeuse.
La luciole c’est une lumière dansante pour éblouir la femelle dans une nostalgie d’amour dansée.
Ma recherche de lumière est la recherche d’une lumière proche de celle que l’on peut observer dans les intérieurs japonais, sans éclat agressif.
En Occident, nous aimons le blanc absolu qui fait ressortir d’une manière très vive la couleur. Au Japon, j’ai fait l’expérience de vivre dans des intérieurs où tout était en mi-teinte, grisé, beige, et mes yeux se sont habitués à voir cette lumière très douce.
Si j’ai été si touchée par la culture japonaise, c’est qu’il y avait quelque chose qui ne se disait pas. J’aime ce qui est diffus, parce qu’il y a quelque chose qui ne se dit pas tout à fait. Qui ne cherche pas à séduire.
Quand on affirme quelque chose avec éclat, on est dans la confrontation.
Ce que j’aime dans les lumières diffuses, tamisées, c’est qu’elles évoquent quelque chose qui n’est pas là.
C’est cette lumière que j’aime et que je recherche, cette diffusion lente.
On retrouve cette idée, non pas de temps arrêté, suspendu, mais presque de «contre- temps» par rapport à la vitesse du monde…
Il est devenu devenu très difficile de garder du temps pour notre pensée et un espace pour créer, parce que nous sommes sans cesse dérangés: des mails auxquels il faut répondre, des
SMS soi-disant urgents, mille taches en retard, des appels, des messages, des messages, des messages…Quelle tyrannie!
J’essaie de préserver un temps consacré à la pensée, au silence, au rêve, à l’amour…
Tu évoques volontiers la notion d’amour. Dans quel sens un acte artistique est aussi un acte d’a- mour?
Je me dis: «Si la création n’est pas un acte d’amour, qu’est-elle?» C’est une manière amoureuse d’être au monde.
Quand je vois quelque chose dans le monde extérieur, quand je rencontre quelqu’un, je suis tou- chée, bouleversée, c’est cela, l’art pour moi.
Cela n’a pas besoin d’être traduit en œuvre d’art forcément. C’est pour moi que c’est une question de survie.
Je ne vois aucune manière d’être au monde en-dehors de cette intensité-là.
Et les petits objets que nous façonnons en tant qu’artistes, ce sont comme de petits messagers de notre âme qui disent, dans ce monde où tout va vite, où il faut gagner beaucoup d’argent pour avoir le sentiment d’exister:
«Regarde, il y a cette autre lumière possible entre nous». C’est un lien.
Je pense à ces petits objets que les humains se sont toujours échangés tout au long de l’histoire de l’humanité dans les différentes cultures, ces échanges de sentiments.
L’artiste offre cela au monde.
Malheureusement, actuellement, le monde ne le comprend plus comme un cadeau, parce que tout est devenu marchand: moi, on me demande combien ça coûte et moi ça me coûte mon sang, ça me coûte mes rêves, ça me coûte ma vie, c’est cela que je donne!
Ce don, c’est aussi une manière de provoquer une relation avec les autres?
C’est leur offrir peut-être une autre petite fenêtre sur le monde, c’est leur permettre de voir ce qu’il y a derrière un arbre, de les inviter à prendre dans la main une feuille lorsque les feuilles tombent, c’est une invitation à lire dans des boules de verre son avenir ou ses amours comme quand on était enfant, c’est le rêve de vouloir rire avec l’autre, de le prendre dans les bras, de l’inviter à aimer la vie… C’est cela qui m’anime.